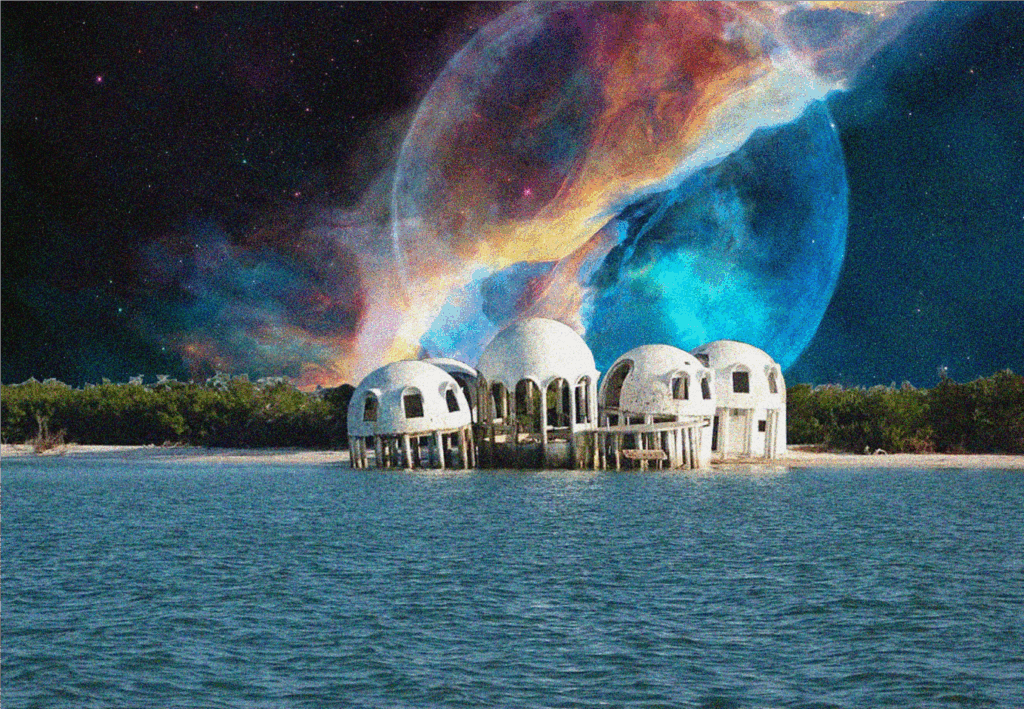Mené par Charlotte Imbault, octobre 2025
Pour les deux premières pièces de votre trilogie, J.C. (2019) et Céline (2022) qui sont des solos respectivement pour Douglas Grauwels et Laure Mathis, vous avez construit des structures dramaturgiques spécifiques aux interprètes. Avec les deux acteurs réunis au plateau dans Pedro, comment avez-vous procédé ?
Sur les deux premiers volets, je travaille avec les acteurs en construisant ce que j’appelle « le chemin de la pensée ». C’est un peu comme le squelette du spectacle. Ce chemin est très écrit, mais les acteurs l’empruntent différemment chaque soir, et ils peuvent également prendre parfois des chemins de traverses. Cela permet une forme de vertige, de liberté, qui est palpable pour le spectateur. Le fait qu’ils soient deux sur Pedro, nous a poussés à inventer une nouvelle façon de faire. Laure et Douglas ne dépendent plus uniquement d’eux-mêmes pour retomber sur leurs pattes si le chemin de la pensée est perturbé : la liberté doit se construire différemment à deux. Nous avons testé plusieurs manières de travailler et nous sommes passés par l’écrit. J’apportais de la matière textuelle ou je retranscrivais des improvisations que je retravaillais ensuite pour leur permettre de retourner au plateau. Dans un second temps, j’ai précisé les articulations de la pensée, établi le chemin, comme pour les solos, en leur demandant de se détacher du texte. Je tiens à ce qu’ils se départissent de la fidélité du mot à mot que l’on demande généralement aux comédiens. Ce qui m’importe, c’est que l’on sente la pensée vivante.
Comment se passe l’écriture ?
Le début des répétitions se passe à la table. On ouvre des sujets, on apporte des matériaux qui nous amènent à des réflexions que l’on partage. Puis les acteurs m’aident à écrire en improvisant au plateau sur les canevas précis que je leur propose. Au fur et à mesure, les choses commencent à s’agencer et c’est comme ça qu’apparaît le chemin de la pensée. L’écriture se fait aussi par couche, avec l’aide de tous les collaborateurs artistiques. Antoine Richard, le créateur sonore, a été très présent dès le début du travail sur Pedro, et nous avons cherché ensemble le ton du spectacle. Victoria Aime nous a, quant à elle, aidés à trouver une langue.
Quelle est cette langue ?
Douglas et Laure qui incarnent les personnages de José Manuel et Beatriz, inspirés de l’univers de la Telenovela, parlent avec un accent espagnol. Je ne voulais pas de caricature. Victoria Aime qui est autrice, dramaturge et metteuse en scène, d’origine espagnole, nous a aidés à écrire la poésie de cette langue. Je lui disais que j’avais envie que l’on s’inspire du livre Pas pleurer de Lydie Salvayre dans lequel l’autrice parle de sa mère, de ses origines et décrit le fragnol, ce mélange entre le français et l’espagnol. Victoria venait assister aux répétitions, puis en voyant les improvisations, les scènes qui passaient ou repassaient, elle y ajoutait sa couche que les acteurs incorporaient au fur et à mesure. Au-delà de la langue, pour travailler l’écriture de ces spectacles, nous nous inspirons de la figure. Et là aussi, tous les créateurs du spectacle s’en saisissent comme Pauline Kieffer, créatrice des costumes, ou encore Maurine Baldassari, créatrice des perruques, car les acteurs jouent et improvisent différemment en fonction de leur costume et de leur perruque. Ce sont de véritables masques qui nous aident à écrire autour de la figure.
Que recouvre ce mot ?
La figure, c’est la source d’inspiration. Pour les deux spectacles précédents, J.C. et Céline, les figures étaient Jean-Claude Van Damme et Céline Dion. Pour Pedro, c’est un peu différent, on n’incarne pas Pedro Almodóvar, mais on s’inspire de son cinéma. Cette fois, les personnages créés sont fictifs. Ce travail sur la référence à une figure populaire est un des points communs de la trilogie. Il y en a d’autres bien sûr. L’adresse publique se retrouve sur les trois volets, comme une volonté de se parler vraiment, de partager une pensée et un moment. Il me semble également que chaque spectacle essaie de travailler sur l’inconscient collectif. Et pour cela, je fais appel à des archétypes, ces images, ces modèles qu’on retrouve à travers le temps, dans différentes cultures. Pour Pedro, j’ai choisi de travailler autour de ce qu’on pourrait appeler l’archétype du couple, qui a tant construit notre société. Les personnages sont ancrés dans cette obsession et incarne, d’une certaine manière, une version archétypale d’un couple dans laquelle beaucoup de personnes peuvent se retrouver.
Qu’implique de travailler l’archétype ?
L’archétype, j’essaie de le réfléchir, de le regarder et de le questionner, peut-être de le déplacer. Dans Pedro, les personnages vivent une métamorphose. Le chemin qu’ils pratiquent est celui que nous avons pris pendant le temps de la création. Le point de départ était la question du plaisir, et au début des répétitions, j’étais vraiment partie sur ma rencontre avec L’amant de Lady Chatterley de D. H. Lawrence, sur l’idée d’une plongée intime dans le plaisir. Au fil des répétitions, en creusant notre sujet, nous avons croisé l’histoire de l’oppression de la femme, la place de son corps dans les enjeux politiques, de domination et de contrôle, nous avons rencontré Emma Goldman, anarchiste militante du début du siècle qui rapprochait la lutte contre le capitalisme, l’oppression qu’il engendre et l’assujettissement subit par les femmes. Je n’avais pas anticipé de manière aussi claire la rencontre entre le politique et l’intime pour ce projet. Au cours du travail, j’ai réalisé que j’étais tout simplement incapable de penser mon désir librement, ayant grandi dans le bain patriarcal. Conscientiser cet impensé fut vertigineux. Et au-delà de la tristesse et de la colère qui ont accompagnées cette prise de conscience, je me trouvais dans l’incapacité de parler d’autre chose que de ça. De cette liberté. Ou plutôt de cette inacceptable incapacité à être libre. Nous nous sommes beaucoup inspirés du livre Le Mythe de la virilité, un piège pour les deux sexes d’Olivia Gazalé, qui est l’essai-socle de la pièce. Le spectacle est la prise de conscience de cette injonction au mythe viril et de ce qu’il implique au niveau intime, pour les femmes comme pour les hommes. L’intimité est un peu le dernier tabou de ce qui se génère de patriarcal dans les rapports humains et la BD L’Origine du monde de Liv Strömquist le démontre très bien.
Malgré le conditionnement, est-ce possible d’arriver à un désir libre ?
Je ne sais pas si c’est possible, mais prendre conscience de notre conditionnement, c’est quelque chose qui permet un mouvement. Je ne peux pas penser mon plaisir, rêver mon plaisir si je ne suis pas libre. Et cette liberté, nous devons la reconquérir ensemble je crois.
Le changement doit se passer dans nos façons de voir. De se voir soi et de voir l’autre. Au-delà de la question du genre, se placer au-dessus de l’autre, quand ce n’est pas consenti, empêche la relation à l’autre. C’est la domination qui est, à mon sens, l’entrave majeure à notre liberté, à la jouissance, à l’amour. Et ce sont des zones aveugles que ce couple essaie de mettre en lumière devant nous, comme une expérience commune, pour essayer de construire un avenir plus libre. En avançant sur les questions qui lui sont propres, Beatriz permet à José Manuel de remettre, lui aussi en question, une domination qu’il subit. Celle de l’injonction à la virilité et à la domination. Et cette métamorphose, les deux souhaitent l’opérer pour eux, mais aussi pour leur enfant. C’est pour les générations à venir qu’il faut ouvrir le dialogue. Il est indéniable que les choses bougent beaucoup, mais il est aussi évident que le chemin vers la liberté reste fragile et dangereux.